
La nécessité dans laquelle l’homme ordinaire s’est trouvé confiné pendant des temps immémoriaux était intrinsèque à sa personne. Il ne connaissait rien d’autre qu’une condition d’assujettissement aux hommes de pouvoir, ainsi qu’à l’ordre naturel dont sa condition ne le préservait pas davantage.
Les individus étaient en besoin de tout et de vie d’abord. Ils n’avaient jamais connu pire situation que la mainmise qui s’emparait de leur vie, à tel point qu’ils n’en réclamaient guère d’autres, même si le désir secret d’un espace moins mortifère, gage d’une liberté insaisissable, voire insoupçonnée, avait pu germer dans leur esprit.
Au XIe siècle, le serf, rattaché personnellement à la terre des domaines et dont on se complaît à dire qu’il n’était l’esclave de personne, est un incapable. Il n’a ni les droits, ni les prérogatives d’un être libre et l’ensemble de ses incapacités sont héréditaires, dont celle de témoigner de sa propre nécessité en particulier.
Le témoignage trouve en effet son expression dans la libre pensée des individus et témoigner constitue l’affirmation de dire une vérité qui affecterait nécessairement le cours d’un événement qui ne saurait être modifié et viendrait contredire le sens d’une vérité soutenue par le maître auquel le sujet doit une dévotion quasi divine.
Faire peser le doute ou l’erreur sur la parole souveraine du maître ou pire encore alléguer son mensonge, est un crime et le crime de parole est l’arme absolue contre les gens de peu ou de rien. De même, la rébellion, voire la révolte opposée à sa condition, à l’exécution des corvées ou au paiement de la taille et il y en eut, pouvait être définitivement réprimée par le fer.
Ces taisants doivent se consacrer au culte du mutisme tant sur leur condition d’extrême nécessité, que sur la critique qu’ils ne sauraient porter sur la condition des autres afin d’en tirer quelque profit.
Le pouvoir de libérer sa pensée qui ne saurait être envisagé, était assimilé à l’affranchissement de l’état de précarité et par là de la nécessité produite qu’il induit sur les individus. La libération de leur pensée les conduirait à remettre en cause le joug de leur condition, mais aussi de contester l’héritage patrimonial de leurs maîtres.
Nul ne songerait à s’extraire de sa condition et tous devaient se satisfaire du privilège de demeurer en vie et de bénéficier d’une protection de circonstance dont l’objectif était celui de sauvegarder un statut de sujet totalement dépourvu de droits et de conscience propres. Impossible alors de justifier la faim, y compris celle de ses enfants pour prétendre commettre quelque faute que ce soit pour y pourvoir et s’exonérer de sanctions.
Ainsi, à l’ordre naturel fait d’une jungle environnementale et animale insurmontable pour l’homme succédait un nouvel ordre tout aussi périlleux érigé par d’autres hommes peu préoccupés du bien-être de leurs semblables.
Il faudra attendre le siècle des Lumières, voire le 19ème pour que l’individu, devenu sujet de droit, affranchisse sa conscience pour qu’il puisse s’émanciper peu à peu et forger ses convictions personnelles sur le terreau des assujettissements que l’histoire lui avait imposés, sans que le code pénal de 1810 cependant, ne comporte de dispositions particulières sur l’état de nécessité.
Le droit de propriété auquel tous pourraient accéder surpassait ainsi tous les autres.
Ce droit avait en effet convaincu la société française de voir en lui le vecteur universel d’une liberté individuelle suprême teintée d’intérêt général, permettant de parvenir au bien-être des hommes.
Ainsi, il était toujours mal aisé pour les individus de combattre leur état de nécessité en commettant un méfait pour y remédier et de s’affranchir de la règle commune, puisque la société permettait de satisfaire les besoins de chacun par la possession et le travail.
La nécessité dans laquelle des hommes pouvaient se trouver n’était dès lors causée dans la conscience collective que par la faute de ceux qui n’avaient pas su utiliser les outils mis à leur disposition dans une société dispendieuse de bien-être.
Mais alors que le droit de propriété devait rendre libre et permettre à tous d’accéder à ce bien-être, on voit que le progrès envisagé, s’il peut satisfaire l’intérêt commun et les bonnes consciences, n’est pas égalitaire car d’abord, les hommes sont différents dans leurs dispositions pour y parvenir et ensuite car l’accès au droit de propriété n’est pas le gage d’une réussite pour tous, alors que les arbitrages mis en œuvre par la société ne permettent pas à tous de se hisser à la réussite personnelle.
On se rend compte que le concept d’état de nécessité apparaît cependant ne pas poser de difficultés insurmontables lorsque l’État s’affranchit de la légalité républicaine en invoquant l’intérêt supérieur, voire la raison d’État pour des motifs d’ordre public et en réduisant le champ des libertés publiques et individuelles.
Il en va ainsi de l’instauration de l’État d’urgence ou de l’utilisation de la théorie des circonstances exceptionnelles lorsqu’aujourd’hui encore pour des nécessités d’ordre social et sanitaire, le pouvoir restreint par décret les déplacements de la population sans l’avis d’un juge indépendant.
Notre société dans une course effrénée au profit est ainsi passée d’une révolution industrielle à la révolution numérique en passant par celle des marchés financiers, ce qui la rendait moins apte pour s’affranchir de la règle commune en se portant au secours de malheureux en proie à une délinquance liée à la nécessité, mais aussi moins apte pour devenir magnanime et soucieuse de construire un intérêt général qui s’enorgueillirait de punir d’autres coupables, roués ceux-là, jugés par une magistrature indépendante.
Mais cette révolution judiciaire, n’a jamais investi l’esprit des législateurs, ni mobilisé celui des juges à vrai dire.
Il nous faudra attendre de lire les premières décisions de justice courageuses rendues par des magistrats progressistes et le premier d’entre eux fut le juge Paul Magnaud (1848 -1926) d’abord inscrit au barreau, avant d’intégrer la magistrature en 1880, pour y tenir tour à tour les fonctions de substitut à Doullens, juge d’instruction à Montdidier, Senlis et Amiens, avant de prendre la présidence du tribunal de Château-Thierry...
Paul Magnaud, fils d’un petit fonctionnaire de province et marié avec l’une des premières féministes Marie-Thérèse Beineix – ce qui peut aider - avait le profil atypique du juge, profondément humain d’abord, et citoyen à part entière dans la cité ensuite. Il en existe encore beaucoup de cette trempe.
Ce magistrat exerçait avant tout son office en interprétant la loi sans la trahir, mais en forgeant sa jurisprudence en considération de la dimension humaine puisée dans chacun de ses dossiers. D’ailleurs, ne serait-ce pas la première qualité du juge de tendre d’abord la main aux hommes plutôt que l’oreille aux sirènes du pouvoir ?
Ce juge relaxait ainsi le 4 mars 1898 Louise Ménard, jeune fille-mère de 22 ans pour le vol d’un pain car elle, son enfant et sa mère n’avaient rien mangé depuis deux jours. L’état de nécessité judiciaire était né de cette décision éminemment subversive en tant qu’elle constituait le symbole d’une agression inédite faite au droit de propriété. Décision qui fut sévèrement commentée, on le comprend, par la classe politique à quelques exceptions près et la presse, mais qui fut cependant confirmée sur appel du parquet par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 22 avril 1898.
Le jugement rendu par Magnaud relevait d’une part, dans sa discussion que la prévenue sans travail malgré ses recherches incessantes regrettait son geste en reconnaissant la commission du vol. Elle avait un enfant de deux ans qu’elle élevait seule sans l’aide de personne et n’avait pas démérité, d’autre part dans ses motifs : « Il est regrettable que dans une société bien organisée, un membre de cette société, surtout une mère de famille puisse manquer de pain autrement que par sa faute... Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim ».
Le juge Magnaud faisait une application extensive de l’ancien article 64 du code pénal, réservé aux personnes souffrant de troubles mentaux qui énonçait n’y avoir ni crime ni délit lorsque le prévenu au moment de l’infraction se trouvait en état de démence ou y avait été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister, bien que ce texte ne reconnût pas dans la misère ou la faim cette force irrésistible comme une circonstance justifiant l’infraction.
Pour le juge Magnaud, cette force irrésistible qui avait contraint la jeune mère trouvait son expression dans les affres d’une société qui ne permettait plus de nourrir la population qui se trouvait confrontée à deux devoirs impérieux, celui de respecter la loi ou de la sacrifier pour préserver la sécurité des familles en péril.
La question qui se pose est de savoir si la sécurité des populations miséreuses intègre ou non cet ordre public auquel une société régalienne et moderne devrait se consacrer. Était-ce un choix sociétal comme celui de pourvoir à l’accès aux soins, à l’enseignement, à la justice et plus généralement aux libertés publiques ?
Une population précaire, malade, illettrée, sans défense et sous la contrainte ne constituerait-t-elle pas un danger social autrement plus dévastateur en termes d’ordre public ?
Le juge Magnaud créait assurément une notion juridique subversive remplie de questionnement, celle du vol nécessaire !
Son jugement bousculait ainsi les standards de l’architecture du droit pénal, puisque le juge réfutait la commission d’une infraction que l’état de nécessité avait rendue impossible, bien que les faits commis par Louise Ménard réunissaient les trois éléments constitutifs du délit. Le texte de loi sur la prévention et la répression du vol (l’élément légal). L’intention frauduleuse de la jeune femme (l’élément moral) et le corps du délit, à savoir le pain dérobé (l’élément matériel).
La consécration de cette notion d’infraction nécessaire rendait ainsi inopérante la réunion de ces trois éléments. La volonté assumée de Louise Ménard avait été celle de préserver sa famille d’un péril imminent en s’affranchissant de la loi pour commettre un vol, sans qu’elle n’ait cédé d’aucune manière à une force extérieure et irrésistible ou le vice.
Par cette décision, le vol d’un pain commis par cette jeune femme maladroite qui se faisait interpeller en sortant de l’étal du boulanger et qui passait aux aveux, constituait sans doute une blessure faite au droit, pour reprendre l’expression tenue par un avocat général lyonnais près de deux siècles plus tard, au sujet d’une autre retentissante affaire de vol de nécessité, dite l’affaire d’Agnès en avril 2001. Une mère de famille de sept enfants dans une précarité extrême qui, la veille de Noël 2000, avait dérobé dans un supermarché de quoi satisfaire en marchandises cette fête qu’elle voulait consacrer au bonheur de ses enfants.
Mais cette blessure aux yeux du juge Magnaud était de moindre importance que celle que la jeune mère aurait eu à subir par l’abstention de son geste.
De nombreux commentateurs de l’époque avaient fustigé l’interprétation légale faite par le juge Magnaud, car selon eux, elle bousculait l’ordre établi, favorisait le vagabondage, la paresse et la récidive et compromettait la sécurité de la propriété des biens, alors que la précarité qui était toujours appelée à perdurer, constituait tout au plus une circonstance atténuante.
L’Intransigeant évoquait le « plus formel des réquisitoires contre la société », L’Echo de Paris s’élevait contre ce juge « qui avait osé acquitter une voleuse ». Une autre tribune publiée dans les colonnes du Journal des Débats y voyait le risque de la « suppression de toutes les lois autres que celle de la lutte pour la survie », alors que Le Figaro titrait « La propriété a des droits ! ».
D’ailleurs la cour d’appel d’Amiens qui confirmait la relaxe de Louise Ménard, plus prudente, la fondait sur le défaut d’intention criminelle et non sur l’état de nécessité, préférant ainsi privilégier la piste d’une infraction dépourvue d’élément moral.
Le parquet, quant à lui, soutenait le principe de la condamnation de Louise Ménard coupable d’avoir commis une infraction avérée en droit et reconnue en fait. Il souhaitait de surcroît que les attendus du président Magnaud mettant en cause l’organisation sociale soient censurés et supprimés, comme si la société dont le ministère public défendait les intérêts ne devait conserver aucune mémoire de ce jugement pervertissant la règle de droit.
Cette décision était en effet un pavé transgressif dans la mare d’une justice dont il n’était pas imaginable de malmener le cours tranquille, même si l’acte de juger est par nature un acte violent dont les sentences modifient toujours le cours d’une existence.
Un pavé dans la mare qui contrariait une justice habituée à accorder avec une parcimonie toute éclairée les circonstances atténuantes aux fautifs.
Un pavé dans la mare dans le concert des décisions compassionnelles parfois teintées de charité, mais oublieuses que la justice n’était plus rendue au nom de Dieu, mais au nom d’un peuple souverain bien souvent confronté à la misère.
Un pavé dans la mare d’une société individualiste et défaillante qui devrait prendre soin des malheureux, mais incapable de leur offrir une insertion sociale pérenne, alors que les disettes et la souffrance au travail étaient récurrentes et que les femmes comme toujours en étaient les premières victimes.
Un pavé jeté dans la mare de la pensée conservatrice violemment agitée ici par la réflexion innovante de ce juge qui s’immergeait dans la douleur des autres en oubliant la considération qu’il devait à l’application stricte de la loi, mais également à sa hiérarchie forcément en désaccord avec lui. Mais cet homme était tout aussi éloigné des inflexibilités d’une révolution industrielle profiteuse et dépourvue d’humanité, qu’il se trouvait être en proximité avec les gamins de six ans noircis par le charbon qui creusaient et mourraient dans les mines.
L’homme de loi avait ainsi utilisé son pouvoir loin des usages et de la condescendance judiciaire.
Il mettait au jour une vérité jamais écrite aux dimensions humaines qui avait la témérité de se substituer aux autres.
Il savait que lui seul, investi de fonctions régaliennes, pouvait être habilité pour le dire, l’écrire et être entendu au nom de tous les taisants qui ne le seraient jamais.
Et cet homme non satisfait de prononcer une relaxe motivée sur une infraction caractérisée, créait le concept novateur d’une responsabilité collective de la misère des hommes, en leur ôtant le fardeau d’une preuve impossible !
Et l’inlassable Paul Magnaud déposait auprès de la chambre des députés une pétition en faveur d’une loi de pardon par laquelle il demandait le vote d’une modification de l’article 64 du code pénal pour y insérer l’exonération pénale de l’auteur d’un vol de première nécessité commis pour contrer une misère extrême. Il n’y aurait en conséquence ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le prévenu « a accompli l’acte incriminé en état de nécessité, afin de préserver autrui d’un danger ou d’un dommage présent, imminent, injuste, qu’il n’a pu détourner qu’en exécutant l’acte qui lui est reproché et à condition que le mal causé soit moindre que le mal évité. ».
La presse avait intitulé cette proposition, la loi humaine que certains contempteurs avaient qualifié de consécration inacceptable du droit au vol et ce texte ne fut jamais adopté.
Nous devenions cependant les héritiers d’une pensée juridique exemplaire et garants de la façon nouvelle dont la société traiterait la délinquance causée par la pauvreté, quelles que soient les dispositions de chacun pour y remédier.
Il nous serait désormais permis d’exhorter cette société à résoudre le désordre social, jusqu’à ce qu’elle en prenne acte et modifie ses priorités.
Mais encore aujourd’hui les perspectives tracées par le juge Magnaud ne sont toujours pas toutes admises par le corps social. Il en est ainsi de ses décisions, à quelques exceptions près infirmées par la cour d’appel, qu’il avait rendues sur la mendicité, la condition des femmes - en particulier en matière d’avortement – la délinquance des mineurs, la garde alternée, les accidents ou les maladies du travail.
Il nous faudra attendre encore un siècle en 1994, pour qu’une loi instaurant l’état de nécessité modifie le code pénal avec l’article 122-7 rédigé ainsi : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. ».
Le législateur mettait ainsi en place les outils d’une infraction nécessaire qui trouverait sa cause dans un danger réel et imminent, devenu inévitable qui conduit l’auteur à commettre une infraction nécessaire à sa sauvegarde, pourvue de proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Le texte se montre prudent et ne nomme d’ailleurs pas formellement l’état de nécessité. Il se borne à le qualifier et la réponse donnée à l’évènement dangereux dans toute sa progression est à l’appréciation de son auteur sous le contrôle souverain du juge qui l’avalisera ou pas.
L’étude de la jurisprudence établit que les juges sont bien souvent indisposés pour authentifier l’état de nécessité et portent encore leur préférence sur le défaut d’élément moral de l’infraction. Cette réticence conduit également la défense à se montrer parfois peu convaincue de s’y risquer pour ne pas heurter un tribunal propice à la relaxe. Ces choix participent également à l’élaboration d’une jurisprudence chaotique qui tergiverse comme si l’état de nécessité était une chose trop signifiante pour s’en emparer, une posture politique inappropriée, dangereuse et mal appréciée par une cour d’appel qui ne manquerait pas de cataloguer leur auteur. Les juges ne supportent que difficilement l’idée d’être abusés par un usurpateur qui ferait passer le plaisir de la paresse en précarité, mais à force de vouloir identifier le méritant, peu ne trouvent grâce à leurs yeux.
Ainsi, on peut affirmer que l’état de nécessité est toujours sous employé, même si l’on trouve quelques cas significatifs dans le droit pénal de la famille en matière de non représentation d’enfant lorsque l’un des conjoints refuse de remettre l’enfant pour des raisons liées à l’insuffisance alléguée des mesures de protection. La circulation routière nous offre également son lot de revendications liées à l’état de nécessité, qu’il s’agisse de conduite d’un véhicule sans permis ou sous l’emprise de l’alcool, où les raisons personnelles des uns rivalisent d’imagination avec celles des autres, et j’en passe...
L’une des dernières décisions intéressantes fut relative à la commission d’un délit de violation réitérée du confinement rendue par le tribunal correctionnel de Cusset, qui avait vu une personne sans domicile fixe verbalisée à plusieurs reprises et déférée à l’audience des comparutions immédiates par le Procureur de la République. L’homme qui ne savait ni lire ni écrire, ne disposant de surcroît ni d’un téléphone portable, ni d’une imprimante pour rédiger une attestation de déplacement dérogatoire et souffrant d’une pathologie mentale, fut allègrement condamné à de la prison ferme. Difficile cependant de vivre à l’abri lorsqu’on en est dépourvu, ce qui ne sautait pas aux yeux de tout le monde...
On est loin de la hauteur de vue des décisions rendues par le juge Magnaud qui inscrivait l’état de nécessité dans le droit de ne pas mourir de faim dans une société qui ne prenait pas ses responsabilités pour remédier à la misère.
Notre société dite moderne nous offre aujourd’hui cependant tant de raisons pour exprimer la prégnance des évènements majeurs qui relèvent de l’état de nécessité, car on est passé en un siècle du désir du droit de vivre sans misère, au désir du droit de ne pas mourir sur une planète polluée ou corrompue, en passant par celui de ne pas périr sans liberté dans son pays.
Ainsi, que sont devenues les grandes causes liées aux infractions commises au nom de l’état de nécessité par ceux qui refusent de vivre sur une terre polluée pour ne pas avoir à subir les dévastations climatiques Que sont devenues les causes portées par les lanceurs d’alerte qui transgressent les législations de leurs pays au péril de leur vie en interpellant les nations pour que soient dénoncés, identifiés et jugés les corrompus avec leur cohorte d’évadés fiscaux ou les auteurs d’exactions de toutes sortes en particulier financières. Que sont devenues les causes de ceux qui secourent et assistent aux frontières les personnes migrantes en proie au danger des famines, des guerres, des crimes ou des intempéries climatiques ?...
Combien de décisions sont rendues sans considération de l’état de nécessité provoqué par la commission de ces graves dysfonctionnements ?
Combien de poursuites pénales sont ordonnées sur les crimes et délits révélés par ces infractions rendues nécessaires par ces dangers réels et imminents ?
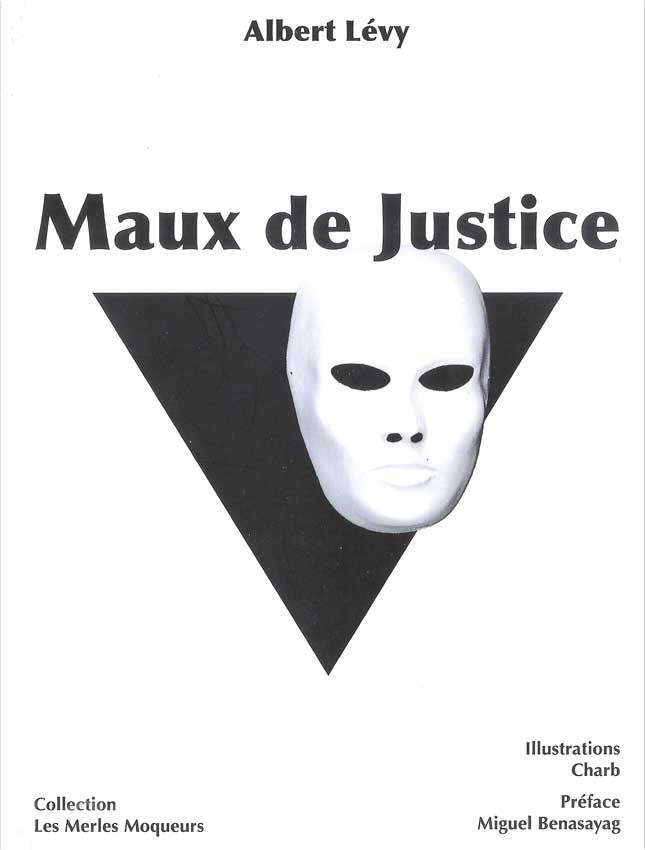
Nous savons que l’Europe d’aujourd’hui ne serait pas l’Europe, si de tout temps les peuples n’avaient pas été secourus au cours de leurs migrations, alors que les politiques migratoires menées ici et là restreignent drastiquement les entrées sur territoire des personnes étrangères, le plus souvent interpellées pour être reconduites à la frontière.
Des gens de bonne volonté se piquaient alors de porter assistance aux migrants en violation des prescriptions de loi, prises dans une lecture rigoriste. Ils pensaient que cette chasse à l’homme d’où qu’il vienne était une aberration, un drame, un outrage fait à l’humanité qui devait tordre nos consciences jusqu’à la nausée, alors que La France était condamnée à six reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), pour avoir placé des enfants étrangers en centre de rétention en les privant de liberté.
Certains d’entre eux pensaient qu’avec les désordres climatiques en particulier, nous étions tous des réfugiés en devenir. Que des hommes en danger mais encore libres dans leur esprit devaient pouvoir échapper aux turpitudes de leur condition et que d’autres terres porteuses d’espoir leur permettraient de vivre dans la dignité.
On en est alors arrivé à condamner sévèrement ces gens pétris de générosité qui avaient prêté leur aide à des migrants en péril, en leur fournissant de la nourriture, des vêtements ou un toit.
La médiatisation souvent péjorative de tels agissements devait finir par convaincre les populations sensibilisées par la détresse de migrants, que le délit d’aide au séjour irrégulier n’était rien d’autre qu’un délit de solidarité punissable qui ne s’inscrivait pas dans la philosophie de l’infraction nécessaire et que la récidive les conduirait inexorablement en prison.
La société marquait ainsi les esprits par les poursuites pénales inflexibles engagées par les procureurs en faisant de la solidarité une faute sociale et non pas un devoir impérieux d’humanité recevable.
Qui peut rester insensible aux terribles tourments subis par la planète, provoqués par les pollutions incessantes auxquelles les hommes se livrent et dont le réchauffement climatique est le signe annonciateur ?
Qui peut convaincre les dirigeants du monde de ne plus poursuivre inexorablement leurs réalisations nuisibles au préjudice des peuples en laissant prospérer ce drame climatique pour l’air, la terre et les mers qui seuls, pérennisent la vie des hommes depuis des temps immémoriaux ?
D’aucuns, des scientifiques, des hommes d’esprit, des hommes de toute condition ont pris la parole, d’autres ont fait le choix d’écrire, de justifier, de militer et de manifester, mais rien ne semble rompre l’inlassable dessein que les décideurs nous préparent.
Alors, il en est, souvent des activistes, des pacifiques qui décident de provoquer les consciences...
Il en a été de ceux qui avaient décidé en février 2019 de décrocher les portraits présidentiels dans les locaux d’une mairie lyonnaise, comme pour en faire le symbole d’une infraction devenue nécessaire, voire indispensable pour obtenir l’écoute urgente dont la cause écologique devait être l’objet, dans un contexte où la France n’avait pas respecté les accords de Paris de la COP 21 en 2015 qu’elle avait initiés.
Les deux jeunes militants étaient poursuivis par le parquet pour avoir dérobé en réunion ces portraits, alors que leur intention ne s’inscrivait certes pas dans une volonté d’appropriation définitive de ces biens, mais d’influer sur la volonté de la France qui prenait du retard à respecter la diminution des gaz à effet de serre qu’elle s’était engagée à contenir. Le Bureau de Lutte Antiterroriste de la Gendarmerie Nationale (BLAT) relevait d’ailleurs à ce propos « qu’il ne s’agissait pas de vols, mais d’atteinte à l’autorité de l’Etat. »
Le tribunal correctionnel relaxait les prévenus en ne citant à aucun moment les termes de l’article 122-7 du code pénal, ni l’état de nécessité, mais il relevait que le choix de soustraire le portrait du Président s’inscrivait dans le cadre de nouvelles formes d’expression des citoyens dans un État démocratique, dans une action qui revêtait un caractère manifestement symbolique, dont le trouble à l’ordre public était faible et qui pouvait se comprendre comme un substitut nécessaire au dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple.
Le jugement tirait enfin argument de l’absence de constitution de partie civile de la Ville de Lyon qui jetait un doute sur sa volonté de récupérer son bien.
Cette décision qui se voulait exemplaire dans la relaxe se montrait cependant maladroite et prudente dans l’exposé de ses motifs, puisqu’elle ne relevait ni ne justifiait le danger actuel et imminent voire inévitable que la carence de l’État faisait peser sur l’avenir climatique de la France, pas plus qu’elle ne mettait l’accent sur la proportionnalité entre les moyens employés par les prévenus pour conjurer le danger et la gravité de la menace, pour qu’une infraction nécessaire soit commise.
La cour d’appel infirmait en conséquence et sans trop de difficulté le jugement rendu en premier ressort en constatant que l’infraction était caractérisée.
Elle accordait les circonstances atténuantes aux prévenus condamnés à 250 euros d’amende.
... Il faudra encore du temps pour que l’infraction nécessaire soit admise comme l’expression naturelle de la préservation d’un devoir supérieur à l’application d’une loi en décalage avec les essentialités d’une société contemporaine !