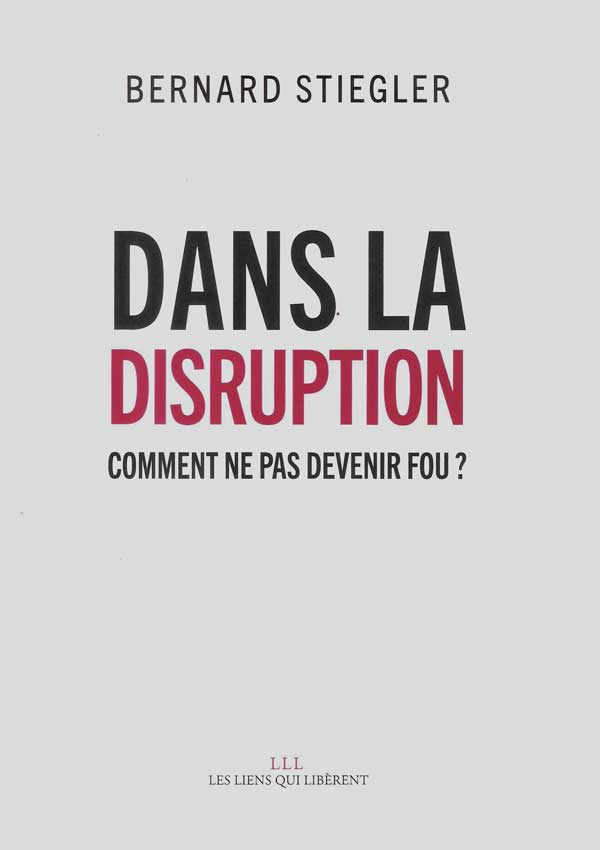
Laissons l’auteur définir lui-même cette notion de disruption : « La disruption est un phénomène d’accélération de l’innovation qui est à la base de la stratégie développée dans la Silicon Valley : il s’agit d’aller plus vite que les sociétés pour leur imposer des modèles qui détruisent les structures sociales et rendent la puissance publique impuissante. C’est une stratégie de tétanisation de l’adversaire. » C’est ainsi que Stiegler annonçait son livre avant même sa parution (Le Monde du 19.11.2015).
A le lire - chemin parfois escarpé mais avec un bon guide qui se soumet lui-même à un « courage de la vérité » - on ne devient pas forcément « fou » mais on peut prendre peur. Et, au mieux, prendre conscience que le monde est désormais embarqué dans un système, un « avenir technologique », aussi bien une machine qu’une machination, qui, dans l’heure, s’affole, provoquant des phénomènes d’accélération (des connexions aux deux tiers de la vitesse de la lumière) absolument foudroyants. L’effet essentiel en est une processus de désindividuation, psychique et collective, qui exténue dans une tâche impossible : courir derrière ce qu’aucun ni ensemble ne peuvent maîtriser. Il en résulte deux phénomènes importants qui caractérisent notre « époque » (devenue en l’occurrence une « absence d’époque » en rendant obsolète toute concordance qui caractérise une époque) : la transformation de tous les acteurs, individuels et collectifs, en fournisseurs de data, et la dépossession de leurs désirs et volontés (la dépossession de leurs données ou « rétentions » les dépossède par effet de retour de leurs projections ou « protentions »). Ce qui pourrait expliquer les différentes formes de désespoir, de désinhibition et de « folie » auxquelles on assiste actuellement.
Stiegler renoue ici avec la thématique de l’industrie des biens culturels de Theodor Adorno et Max Horkheimer qui annoncèrent, dès 1944, une « nouvelle forme de barbarie ». On y serait donc apparemment, sous la forme désespérante d’arriver de plus en plus en retard sur ce qui nous arrive en quelque sorte ! Elle nous fait courir derrière un monde déjà calculé et anticipé par l’économie des data.
Cela laisse la terrible impression d’une tumeur visible/invisible qui ronge le monde en prenant de vitesse tous les sujets dans ses algorithmes. Les sujets ou ce qu’ils sont peut-être déjà devenus : des reflets d’eux-mêmes ou des « doubles » dans leurs interfaces numériques. Cette schize ou cette bizarrerie (ou cette folie) est silencieusement normalisée : nos traces (laissées partout sur nos écrans et de plus en plus sur tout autre machine à capteurs), ne font plus archives (rétentions) noétiques, mais matière à anticipations dans une économie qui les retourne sous formes de prescriptions à modéliser les comportements. Là est le processus de « désindividuation », psychiquement aliénant et collectivement « entropique ». Il prive les sujets (notamment les jeunes générations) de leur désir comme de leur raison et les collectifs des raisons d’espérer collectivement. Et là est la source du désespoir, de la folie, et des « nouvelles formes de barbarie » que l’on voit fleurir de différentes manières (dénis, dénégations, désymbolisations, nihilismes, radicalisations, violences excitantes, etc.). « L’accomplissement du nihilisme en quoi consiste la disruption est la radicalisation du processus de désinhibition... C’est l’accomplissement ‘’disruptivement’’ (radicalement) désinhibé du nihilisme qui aboutit à la démoralisation extrême (et extrêmement dangereuse) décrite ici comme ce qui nous conduit ‘’aux bords de la folie’’ (comme perte de la raison que provoque le désespoir, l’absence de toute raison d’espérer) ».
On ne peut poser diagnostic plus noir (ou désespéré) sur « l’époque », mais, à quitter les différentes postures de dénégation (par passivité ou au contraire refus de l’avenir technologique) qu’on y oppose, et à poser un regard avec du recul sur les ruines qui s’accumulent dans tous les champs (politique, social, culturel, religieux, etc.), cela s’avère bel et bien inquiétant. Il faut évidemment arriver à suivre les méandres et les différentes connexions que l’auteur fait pour « tenter de penser » cette nouvelle forme de la barbarie. Elles sont à la fois conceptuelles, historiques, informationnelles, épistémologiques, pragmatiques et même personnelles (ancrées dans l’expérience propre de l’auteur ou « l’épokhé de [sa] vie »). Mais, en terme d’interrogation, ils aboutissent sans doute sur l’épreuve la plus urgente de notre époque/absence d’époque : « repenser les statuts non seulement de la folie, mais du rêve en tant qu’origine de la noèse ». Ces deux facultés humaines vont ensemble : ne plus pouvoir rêver rend fou, inventer par contre de nouveaux rêves est ce qui peut nous sauver (les deux facettes articulées du pharmakon : ce qui est toxique, l’ubris ou la démesure au cœur de la technique moderne – visage actuel mais dénié du capitalisme computationnel – est en même temps le remède, le rêve, c’est-à-dire « le point originaire à partir duquel la liberté se fait monde » (Biswanger). Le rêve est ce qui permet de « bifurquer néguantropologiquement », une dimension de notre condition existentielle. C’est le grain de sable (dans la machine), le défaut de langue ou d’origine, la différence, le supplément, le déplacement, l’écart ou l’hybride qui fait bifurquer ou dériver l’espace-temps. C’est ce qui nous permet sans doute et en fin de compte de résister à l’injonction disruptive fellow (suivre) que l’on voit s’afficher sur tous les écrans. Autrement dit il faut « politiser la folie » : « Dire que la condition de l’avenir est technologique ne signifie en rien que cette condition est une solution : cela signifie tout au contraire que cette condition est un problème (et non seulement une question), et qu’une ‘’grande politique de la technologie’’ est requise, qui doit devenir une ‘’grande santé’’, c’est-à-dire une transvaluation »... En fin de compte, Dans la disruption fait rêver plus qu’il ne rend fou !
Abdellatif Chaouite