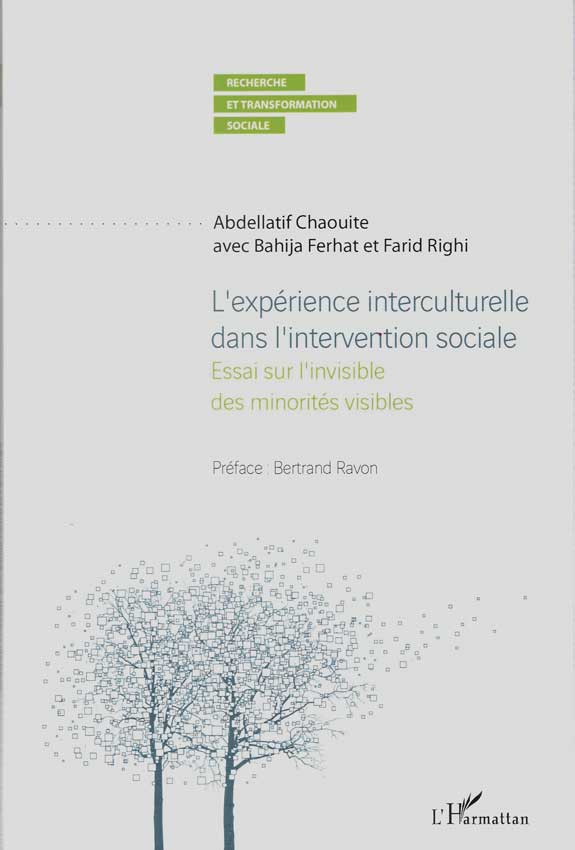
L’expérience interculturelle dans l’intervention sociale est un livre dense, qui s’adresse bien au delà du cercle des travailleurs sociaux. Toutes celles et tous ceux qui cherchent à construire un chemin d’émancipation social devraient lire l’essai d’Abdellatif Chaouite, Bahija Ferhat, et Farid Righi.
Dans sa préface Bernard Ravon nous livre dans une phrase le sens de cet essai sur l’invisible des minorités visibles : « Ouvert au charme de l’imprévu, ce livre est également orienté par des savoirs situés, des savoirs qui tirent leur force de l’expérience à travers laquelle ils se sont constitués... En l’occurrence, c’est en voyant d’en bas depuis une expérience de la domination ou du mépris social que ces savoirs ont été constitués ». Les auteurs ne se cachent pas, ils nous disent d’où ils parlent dans un long chapitre intitulé « Nous », ils expliquent qu’ils sont des citoyens interculturels produit d’« un long dialogue intérieur continu entre tous nos héritages ».
Roland Gori dans son dernier ouvrage l’individu ingouvernable rappelle fort justement que la construction du commun « Oblige » ; Il est trop facile dans chaque discours, dans chaque document de glorifier le « Vivre ensemble » encore faut il se donner les moyens de le fabriquer et de le faire vivre. Dans cette perspective ce livre est outil, il est une contribution à l’avenir de la société française. Lorsque la globalisation modifie en profondeur l’ensemble des sociétés, une métamorphose est en marche devant laquelle, si nous ne voulons pas être pétrifiés d’effroi, l’esprit de résistance/création doit nous permettre d’ouvrir les chemins de la justice et de l’égalité sociale.
Le monde dans lequel nous vivons, Pier Paolo Pasolini l’avait finalement admirablement décrit par ces simples mots « la religion du marché » (Ecrits corsaires-1975), le monde de la rationalité technico-financière et des démons qu’elle fabrique. Ces démons vont du trader (repenti ou pas) au sniper, du maffieux à l’assassin djihadiste (repenti ou pas) comme écrivent les auteurs : « En ces temps, de nouveau sombre pour la co-existence des « uns » et des « autres », les langages du soupçon, de la défiance et de la déchéance, de la guerre et du terrorisme prennent le pas sur ceux des politiques apaisées de la relation. Le plus urgent est alors de penser. »
Dans le mythe de Sisyphe Albert Camus écrivait que : « penser c’est vouloir créer un monde » et le premier acte de penser est de mettre des mots, de qualifier le temps présent, en l’espèce, du point de vue du social. Les auteurs consacrent plusieurs chapitres à cette compréhension de cet autre temps qui arrive. Alain Touraine le qualifie de « post-social », Zygmunt Bauman quant à lui parle d’un temps « liquide ». Pour les auteurs le post-social et le liquide sont la grammaire invisible de la métamorphose du social : « cette dimension nous semble pouvoir être saisie anthropologiquement comme l’entrée de la société dans le temps du « scandale de la diversité » ainsi que l’avait qualifié pertinemment Claude Levis Strauss » et de rappeler aussi que Fernand Braudel dans l’identité de la France avait identifié la diversité comme l’autre nom de la France.
Les auteurs sont également allés visiter un philosophe, balayé par la pensée néolibérale, Jan Patocka. Philosophe Tchèque, porte parole de la charte 77, assassiné à Prague par la police politique. Il fut un philosophe et militant de la dissidence dans l’Autre Europe, il nous invite à penser une autre forme de la communauté, « la communauté des ébranlés » qui pour les auteurs est une invitation à demeurer vigilant pour interroger nos pratiques : « dans un sens tourné vers le monde. »
Il faut prendre le temps de picorer cet essai, d’en humer les mots et les saveurs car à un détour de phrase, à un mot mis en valeur, la métamorphose du monde prend une forme « apaisée » avec le souhait de voir émerger une politique de la Relation, face a ce que nous devons considérer comme un rejet de l’Autre ; du débat sur l’identité nationale à l’ignominie du projet de la déchéance de la nationalité jusqu’à la monstruosité historique « de nos ancêtres les gaulois ». Car il faut se le dire aujourd’hui « de vieilles ombres sont de retour, et nous fixent sans trembler » comme l’écrivait Patrick Chamoiseau dans un texte sur le droit à l’errance. Les auteurs en conclusion appellent à un « résister/créer » dont leur essai est un élément de l’immense archipel des résistances.
Bruno Guichard