
Il est d’usage de nommer les espaces frontaliers qui se situent, en particulier, entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement : « zones de transit » des migrants, « porte d’entrée » ou encore lieu d’accueil. L’enjeu étant de souligner les caractéristiques liées aux passages, à sens unique, des pays « pauvres » vers « les pays riches » avec comme arrière-fond la matérialisation des frontières des Etats-Nations comme marqueur, voire analyseur de ces passages. Or, il nous semble que ces archipels de la globalisation (Pierre Veltz, 1997) constituent bien plus que de simples espaces transfrontaliers. Ces zones, ces sas constituent des espaces intégrés qui englobent les territoires indépendamment de leur appartenance nationale. L’interdépendance renforcée des zones transfrontalières et les spécificités qui les caractérisent en tant qu’espace homogène tant au niveau économique qu’au niveau politique et social en font des zones incontournables y compris pour leurs Etats d’appartenance car elles constituent pour eux une possibilité d’intégration dans l’économie mondialisée.
Bien qu’étant régies par les lois nationales, ces zones bénéficient souvent de régimes particuliers qui les rapprochent d’autres archipels de la globalisation : défiscalisation, zones franches, main d’œuvre à bon marché et abondante, investissements publics importants dans les infrastructures, cohabitation entre une élite locale, nationale et internationale à travers les grands chantiers économiques et principalement la finance. Ces zones sont souvent aux marges du modèle national, le droit commun ne s’y applique pas totalement, la dérogation est plus une norme qu’une exception. Les frontières entre le formel et l’informel sont dépassées au profit d’un modèle hybride mêlant les règles de l’Etat social et la dérégulation économique, les préceptes du libéralisme économique et l’acceptation tacite d’une économie en marge qui échappent aux règles officielles du marché. Dans ces zones les circulations des clandestins sont non seulement importantes, mais elles sont le corollaire de ce modèle, malgré les objectifs affichés des Etats de lutte contre la clandestinité du travail ou des personnes (Joppke Christian 1998). Des pans entiers de l’économie sont basés sur ces ressources comme le montre J. Perlman à travers l’exemple des favelas du Brésil (Perlman Janice, 1980) et la notion d’économie souterraine apparaît bien euphémisante devant des activités qui s’étalent en plein jour et qui participent de manière directe (impôts, emplois) ou indirecte (intégration des plus pauvres et rôle de transition vers le secteur économique légal) à la prospérité des territoires. Ces activités que nous retrouvons dans toutes les grandes villes des pays nouvellement développés sont même devenues un indicateur d’une certaine vitalité économique et ont fait l’objet de politiques publiques facilitantes et favorables comme en atteste le programme du Président Lula pour les Favelas du Brésil, du gouvernement Zapatero pour Parla (Banlieue sud de Madrid) ou encore les zones franches de la Politique de la ville en France. À travers ces trois exemples nous observons des politiques similaires : rénovations des logements, politique de transport à l’intérieur et vers l’extérieur de ces zones, incitation à passer de l’informel vers le formel à travers des politiques de défiscalisation, aménagement de règles en ce qui concerne le droit du travail, lutte contre la criminalité qui freine le développement économique, acceptation tacite des activités de l’informel non criminel comme nous l’avons observé dans la région marseillaise dans le cadre d’une autre recherche (El Miri 2005).
Ces territoires nourrissent l’espoir des gouvernements nationaux d’une vitalité économique adaptée aux nouvelles normes de la globalisation.
La zone hispano-marocaine : de l’espace transfrontalier au territoire intégré ?
Il en est ainsi de la zone hispano-marocaine, séparée par 14 km de mer, dont le développement économique s’est accéléré dans les années 1990 et n’a cessé de se renforcer depuis, ce malgré la crise de 2008. Cet espace transfrontalier qui englobe la pointe nord du Maroc, la grande région de Tanger-Tétouan, le sud de l’Espagne avec la zone littorale méditerranéenne de Valence à Malaga et Huelva sur l’Atlantique à la frontière avec le Portugal. Bien qu’étant marqué par un lien historique prégnant d’un côté comme de l’autre, une présence espagnole dans les enclaves de Ceuta et Melilla, cette zone n’a renforcé ses liens qu’avec le développement de cette dernière décennie qui a scellé l’interdépendance des deux côtes.
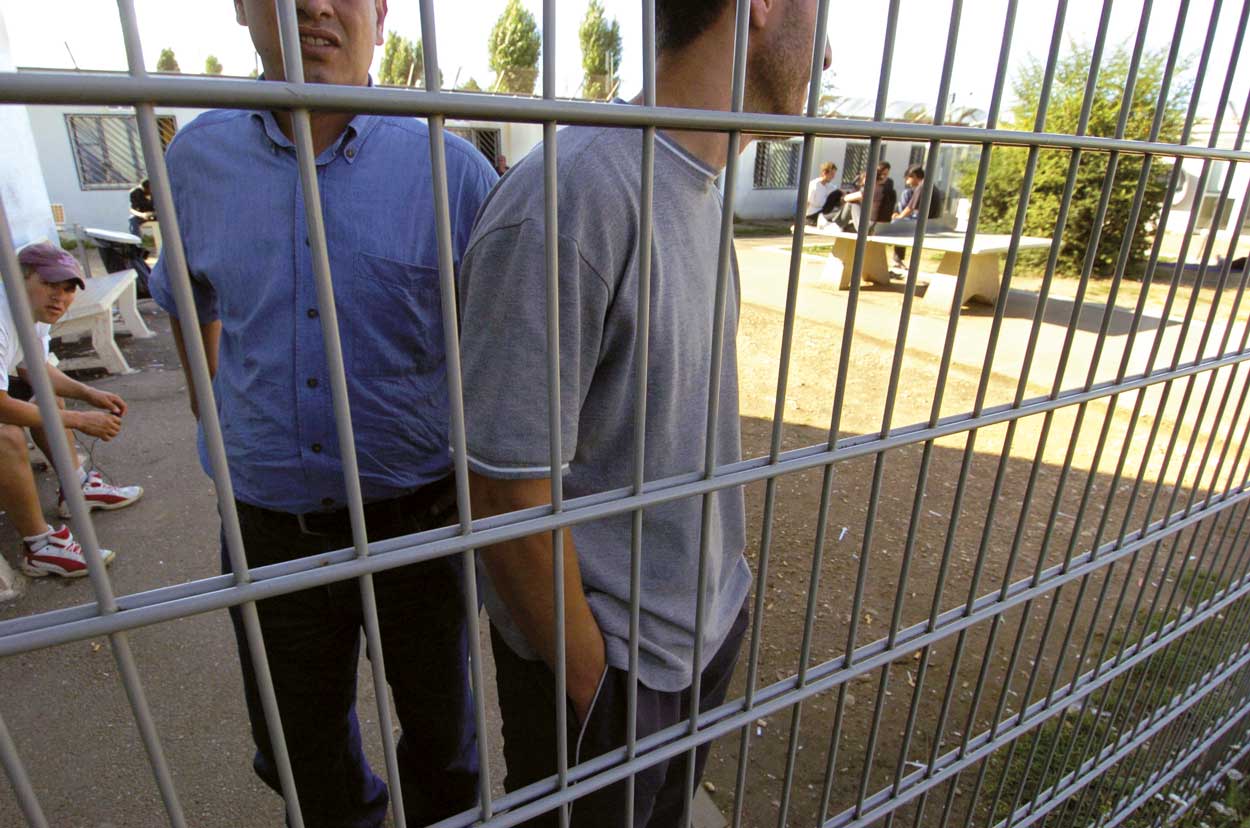
Avec l’adhésion à l’Union Européenne en 1986, l’Espagne a modernisé son appareil productif et son agriculture au point de devenir le principal fournisseur en légumes et fruits de l’Europe. L’Espagne compte la principale superficie cultivable en Europe devant la France, ses produits agricoles génèrent plus de 3 % de son PIB. Les zones agricoles sont installées dans le sud et bénéficient d’une main d’œuvre régulière et irrégulière provenant du Maroc et de l’Afrique subsaharienne. Le nombre de migrants en Espagne est passé de 0,2% en 1990 à plus de 10 %, soit 5 millions en 2010 ce qui a fait passer l’Espagne en moins d’une décennie d’un pays d’émigration à un pays d’immigration [1].
La population espagnole qui a bénéficié de la modernisation économique et des qualifications qui l’accompagne, s’est tournée vers d’autres activités et a vu son nombre d’ouvriers agricoles diminuer, alors que les exploitations s’agrandissaient. L’appel à la main d’œuvre étrangère régulière et irrégulière s’est avérée être une solution incontournable pour s’adapter par le recours au travail non déclaré aux nouvelles exigences de flexibilité internationale (commission Européenne 1998). Cet appel a eu un effet sur la zone marocaine qui est devenue un lieu de transit pour les marocains en partance vers l’Espagne et ensuite un premier point de chute pour les migrants subsahariens. Mais en plus de son intégration dans les besoins agricoles de l’Espagne du sud, Tanger-Tétouan a bénéficié entre 2004 et 2007 de la construction de Tanger-Med qui compte 20% du trafic maritime mondial et d’un développement économique avec l’installation d’une industrie internationale. Tanger-Tétouan est devenue, elle même, une zone de la globalisation, attirant les villageois marocains et africains en quête du mode de vie urbain et d’un travail salarié. La population est passée d’un peu plus de 2 millions en 1994 à plus de 3 millions en 2010 (dernier recensement officiel en 2007). L’objectif de 150 000 emplois affiché par les autorités marocaines (gouvernement Benkirane), et l’arrivée de l’Europe industrielle dans cette zone a eu un effet sur son attractivité et a vu émerger des bidonvilles en dur tout autour de la ville.
Cette zone hispano-marocaine est devenue un espace de reconfiguration des activités économiques du national vers le global ; des territoires ruraux vers la ville ; des modes de vie villageois vers le mode de vie citadin ; d’intégration dans le salariat légal ou le salariat aux marges du droit des anciens paysans et petits indépendants du secteur informel des quartiers populaires. Plus qu’un lieu de passage, Tanger est devenue le début ou la continuité de la zone espagnole, la dynamique de l’une est dépendante de la dynamique de l’autre. Arriver à Tanger, c’est en quelque sorte arriver en Espagne. Pour beaucoup de migrants subsahariens entrer dans cette ville est considéré comme l’arrivée en Europe même si les 14 km de séparation entre les deux continents s’avèrent pour nombre d’entre eux infranchissables.
« (…) le plus difficile c’est d’arriver à Tanger, une fois là-bas, tu as la paix (…) oui la police est toujours là, mais si tu fais attention, tu cherches pas à créer des problèmes personne te demande (…) pour le logement, tu trouves une chambre, il y a des gens qui louent et on loue à plusieurs. Une fois là, c’est bon c’est l’Espagne, après il y a qu’à attendre le bon moment pour passer… » (Entretien près du port de Tanger avec deux jeunes sénégalais).
Les clandestins qui arrivent dans cette zone commencent leur intégration dans le salariat dès l’étape tangéroise, une partie d’entre eux sera employée dans les arrières salles des hôtels et restaurants, dans l’agriculture ou les différentes PME sous-traitantes de l’industrie européenne installée au Maroc. L’enjeu pour ces migrants en circulation est d’intégrer dans un premier temps les marges du marché du travail. Ils ont la certitude que le besoin de ces marges l’emportera sur les législations répressives contre la migration clandestine, Cette impression ne relève pas seulement de l’illusion de l’Eldorado, elle se base sur un constat affranchi des débats médiatiques et des discours politiques hostiles aux migrants. Ce constat est celui des différentes vagues de régularisation, de la forte probabilité de trouver un emploi et de la constitution d’un réseau communautaire installé en Espagne régulièrement, après une arrivée irrégulière. En réalité les migrants clandestins, même provenant de villages, ont intégré la prégnance des besoins économiques sur les discours politiques et font la part entre la législation répressive affichée par la plupart des Etats du monde et la réalité du fonctionnement économique [2]. Ils ont plus ou moins intégré le fait que dans ces zones tampons, l’accès à la citoyenneté est d’abord économique avant d’être politique et les différentes lois de régularisation confortent cette analyse [3]. Dans la plupart des récits que nous avons recueillis dans nos différentes recherches (El Miri 2011, 2014), l’idée que le travail donnerait accès à la stabilité administrative sonnait comme une vérité incontestable et indique l’importance qu’accordent les migrants à la puissance économique, alors qu’une majorité d’entre eux proviennent de zones rurales.

Ainsi ces zones tampons, sont attractives parce que le message qu’elles délivrent est compréhensible par tous. On sait qu’elles permettent une intégration par les marges et l’informel (Joahannes Jütting,
Juan R. de Laiglesia, 2009) et qu’il n’y a pas besoin de correspondre à toutes les attentes administratives pour y trouver sa place. On les sait principalement tournées vers le développement économique à l’international et de ce fait cosmopolite, permettant aux étrangers même illégaux, de se fondre dans la masse. On sait qu’elles se caractérisent par des flux de circulations importants et enfin on sait que les règles répressives affichées sont peu appliquées dans la pratique. Plusieurs pays ont fait le choix de revoir le droit du travail pour s’adapter à la flexibilité plutôt que de renforcer le contrôle et la répression (communication de la commission Européenne 1998). C’était le cas de l’Espagne, de la Grèce, de l’Italie ou encore du Portugal (il s’agit du groupe de pays où le travail non déclaré est supposé être important) qui n’ont pris aucune mesure de contrôle fiscal ou encore de contrôle du marché du travail. Ces pays ont tous adopté des politiques de défiscalisation du travail et d’assouplissement des règles qu’ils ont amplifiées après la crise de 2008.
Même si le nombre de reconduction de clandestins à la frontière est l’objet d’un débat permanent, il n’en reste pas moins qu’il est assez faible au vu de l’estimation des illégaux, comme le remarquait Massey dans le cas des USA (Massey 2005).
Aux frontières des États se substituent les frontières d’un marché du travail qui déborde par les marges sur les réglementations nationales et qui se trouve à l’articulation d’une économie globalisée impulsée par des stratégies étatiques et une économie diffuse aux marges du légal qui s’appuie sur une main d’œuvre produite par l’avancée du salariat et les modes de vie citadins dans les territoires ruraux des pays en voie de développement ou sous-développés.
Dans le cas du Maroc, pays en voie de développement, le salariat a connu une forte augmentation (DEPF, Ministère de l’économie et des finances Maroc 2010) durant cette dernière décennie : en milieu urbain 65% de la population active occupée en 2009 l’était en statut de salarié ; en milieu rural 23% de la population active occupée en 2009 avait un statut de salarié ; cette proportion est d’ailleurs sous-estimée car la CNSS Maroc (Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc) estime que la moitié du travail salarié n’est pas déclaré (étude CNSS). Cette poussée de la salarisation au Maroc a été amplifiée par l’absorption de l’autre côté du détroit de Gibraltar de salariés marocains recrutés dans les exploitations agricoles, le secteur du bâtiment, des services ou encore dans les PME.
La zone tampon hispano-marocaine est un espace de reconfiguration des anciennes économies et des modes de vie. Elle est plus proche par son fonctionnement et les processus qui la caractérisent d’autres espaces frontaliers intégrés dans la globalisation, la frontière américano-mexicaine par exemple (Thierry Fabre 2009), que des espaces nationaux marocain et espagnol.
Dans ce sens les exploitants agricoles du sud de l’Espagne sont plus proches des exploitants agricoles du sud de la Californie ou d’Afrique du Sud. Les salariés clandestins de ces mêmes zones sont eux-mêmes, à des milliers de kilomètres de distance, guidés par les mêmes reconfigurations de modes de vie (Martim O. Smolka et Adriana de A. Larangeira, 2008) marqués par l’urbanisation. La ville de Tanger devient une périphérie des villes Monde (Sassia Sasken 2001) plus marquée par son appartenance au système financier international qu’à l’Etat marocain.
L’attractivité de cette zone résulte d’une part de sa vitalité économique et d’autre part de la superposition des normes formelles et informelles qui favorisent l’intégration des nouveaux arrivants (Deepa Narayan, Land Pritchett et Soumaya Kapoor, 2009).