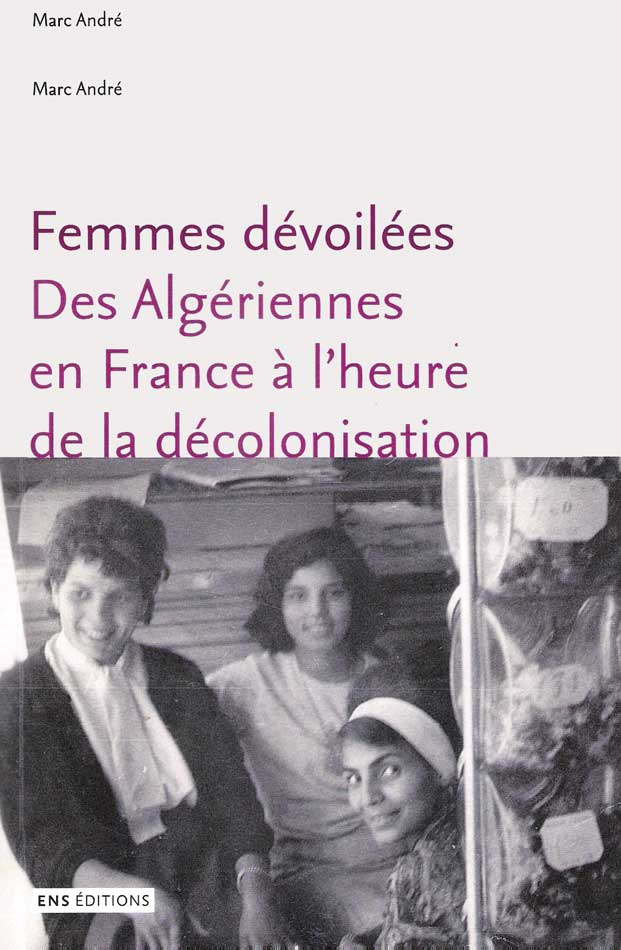
Dans Épitaphe, un poème de 1944, écrit juste avant son arrestation par la Gestapo, Robert Desnos écrivait, telle une réflexion testamentaire : « As-tu grandi la ville où j’habitais ? ». Marc André, avec son livre Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de la décolonisation, redonne aux femmes algériennes toute leur place dans l’histoire de la ville de Lyon, histoire trop souvent occultée. Cette ville qui, encore aujourd’hui, a du mal avec une partie importante de son histoire : de celles et ceux qui viennent des anciennes colonies françaises.
Avec ce livre, Marc André publie une version remaniée de sa thèse de doctorat soutenue à la faculté de Paris-Sorbonne. Dans les pas de J.W.Scott, il définit son objectif ainsi : « donner une visibilité à des personnes jusque là ignorées et corriger l’écriture de l’histoire qui entérine cette exclusion ». Les historiens se heurtant souvent à des zones muettes ou comme le dit Michelle Perrot « à des océans de silences ». Petit rappel et il y en a beaucoup tout au long de ce magistral livre : les femmes algériennes obtiendront le droit de vote en 1958 alors que les hommes algériens l’ont obtenu en 1947, à condition d’accepter le code civil et de rejeter le droit coutumier.
Qui sont donc ces 20000 Algériennes présentes sur le territoire français en 1962, dont 1300 le sont sur l’agglomération lyonnaise ? Ce chiffre important fait qu’elles sont représentatives et repérables ; il autorise donc le travail de l’historien. Marc André situe sa démarche dans la continuation des travaux de Geneviève Massard Guilbaud dans ses deux ouvrages : Enquêtes sur les réseaux de soutien au FLN dans la région lyonnaise (1982) et surtout des Algériens à Lyon de la grande Guerre au Front Populaire (1995). Au-delà de cette visibilité dans l’invisibilité il y a aussi la singularité de l’agglomération lyonnaise qui aura vécu, durant la lutte d‘indépendance du peuple algérien, la guerre civile française mais aussi la guerre civile algérienne marquée par l’affrontement violent et meurtrier entre le FLN et le MNA. C’est aussi à Lyon que la répression judiciaire contre le peuple algérien en métropole fut la plus importante. Sur les douze exécutions des condamnés à mort, onze le furent dans la cour de la prison Montluc de Lyon.
De nombreuses pages de ce livre interrogent notre imaginaire notamment sur les femmes algériennes présentes en France et sur la lutte d’indépendance du peuple algérien.
Marc André a pu reconstituer l’itinéraire de 202 algériennes soit 10% de celles présentes sur le département du Rhône. Ces femmes sont jeunes : la moyenne d’âge est de 28 ans pour celles qui arrivent après 1950, trente quatre d’entre elles seulement ont plus de 40 ans ! Le même constat peut être fait pour les hommes, c’est donc une partie la jeunesse algérienne qui vient en métropole. 62% des hommes sont d’origine rurale et 75% des femmes sont d’origine urbaine. Les raisons de leur venue en France sont multiples. Dans les motivations, il y a l’aspiration à une promotion sociale individuelle mais aussi pour les enfants. Ce qui en dit long sur les « aspects bénéfiques » de la colonisation… comme aiment à le dire certains nostalgiques de l’empire français ! Cette arrivée qui lentement se transformera en exil.
Ces femmes ne sont pas voilées (même dans les rencontres familiales) elles sont habillées comme toutes les femmes de l’époque (de magnifiques photos transmises à Marc André par les familles viennent le démontrer). Même constat sur l’habitat, l’immense majorité des femmes et des familles vivent isolées. C’est Fatima Chikri qui dit : « nous étions la seule famille algérienne à Caluire », Zohra Benkhelifa : « on était au milieu de français dans notre bâtiment » ; et Ourda D. qui fait le même constat sur Bron Parilly. En 1959/1960, 10% des familles algériennes lyonnaises vivent en bidonville. Pour appuyer sa démonstration Marc André a dressé trois cartographies : la répartition des célibataires algériennes, celle des célibataires algériens, des commerces, des bidonvilles et des garnis. C’est donc bien au cœur de l’agglomération que résonne la présence algérienne même si la concentration des commerces et cafés se fait dans « la grande Guillotière », celle des origines, qui s’étendait du 6e arrondissement au quartier de Gerland, du nord au sud de Lyon.
En rappelant la phrase de Gandhi « ce que vous faites pour nous, sans nous est contre nous », Marc André ouvre les formidables pages qu’il consacre aux témoignages des femmes algériennes. Elles prennent la parole, elles disent, elles racontent leur arrivée, leur isolement, leur place durant la guerre d’indépendance algérienne et le choix, pour l’immense majorité d’entre elles, de rester en France à l’heure de l’indépendance ; tout en décrivant et donc en sachant les difficultés administratives qu’elles connaîtraient. Mais toutes disent ce qu’elles doivent à la lutte d’indépendance dans la conquête de leur Liberté. Ces pages sont exceptionnelles, elles disent cette bataille sans fin pour le respect de la dignité. Par exemple on découvre les réseaux relationnels des femmes algériennes entre elles et sans les hommes, que certains militants du FLN voudront détruire au sortir de la guerre d’indépendance. On découvre la violence de l’encadrement des services sociaux français vécus comme une menace comme le dit Mansouria Blaha à laquelle l’assistante sociale déclare « si vous voulez travailler madame, il faudra que nous mettions vos enfants à la DDASS ! » ou Zoubeida Benyamina qui constate que l’assistante sociale qui vient « visiter » sa maman se livre en fait à une inspection complète de l’appartement en disant « Vous, dans les baignoires vous tuez les cochons, vous mettez le charbon ! »
De longues pages sont consacrées à l’opérationnalité des femmes durant la lutte d’indépendance. Cette lutte sera difficile, elle va souvent fractionner les familles, faire naître les traitres comme celui qui arrivait à la Croix Rousse avec les flics mais sous une cagoule pour dénoncer les militantes et militants. Ces femmes vont apprendre à jouer de leur statut de femmes vis-à-vis des forces de répression. Marc André fait le constat qu’elles « sont bien discrètes dans les archives » et rarement une héroïne médiatique, exception faite de Aïcha Bachri, héroïne du MNA ennemi publique du FLN, « passionaria » pour la presse de l’époque. Leur engagement est au croisement de tous les engagements, la quête de la liberté, le devoir civique, le devoir maternel, la rencontre amoureuse… La fonction première des femmes dans cette résistance aura été d’assurer « la fluidité des réseaux ». cette fluidité sans laquelle aucune résistance n’est possible.
A Lyon la répression est venue s’abattre sur le peuple algérien et sur les réseaux de solidarité. Trois lieux disent cette répression : le commissariat de la rue Vauban, la prison Saint Paul pour les condamnés à mort et les femmes à la prison Montluc. Fatma Malagoven pour qui à « Vauban on a eu le martyr par les flics, les flics martyrisaient les gens ». La prison Montluc était également le siège du TPFA (tribunal permanent des forces armées). D’avril 1958 à mars 1962, 854 personnes seront jugées dont 18 femmes. De longues pages inédites sont consacrées à cette répression dont nous retiendrons ici ce constat : les femmes métropolitaines accusées de trahison étaient plus sévèrement condamnées que les femmes algériennes. Marc André consacre quelques paragraphes essentiels à l’affrontement entre le FLN et le MNA illustré par une cartographie inédite. La guerre civile algérienne a fait plus de victimes à Lyon que la guerre entre la France et l’Algérie.
L’histoire de la lutte d’indépendance du peuple algérien est malheureusement aujourd’hui effacée de la mémoire de Lyon alors qu’elle pourrait être un des ciments pour construire une mémoire partagée entre la France et l’Algérie et défaire ainsi ce « nœud gordien » franco-algérien.
En conclusion de son imposant et grave livre, mais si nécessaire pour la France et l’Algérie contemporaines, Marc André nous invite à réfléchir à la complexité en reprenant ces réflexions d’Edgar Morin : « la connaissance scientifique fut longtemps et demeure souvent conçue comme ayant pour mission de dissiper l’apparente complexité des phénomènes afin de révéler l’ordre simple auxquels ils obéissent »… « Quand le mot de complexité, lui, ne peut qu’exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité de définir de façon simple, de nommer de façon claire, de mettre de l’ordre dans le réel » - introduction à la pensée complexe.
A toutes celles et ceux qui voudraient faire fi de l’histoire, faire fi de comment l’identité de la France s’est construite et se construit tous les jours, ce livre vient nous rappeler notre nécessaire vigilance devant les mensonges et les non-dits. Un livre salutaire.
Bruno GUICHARD