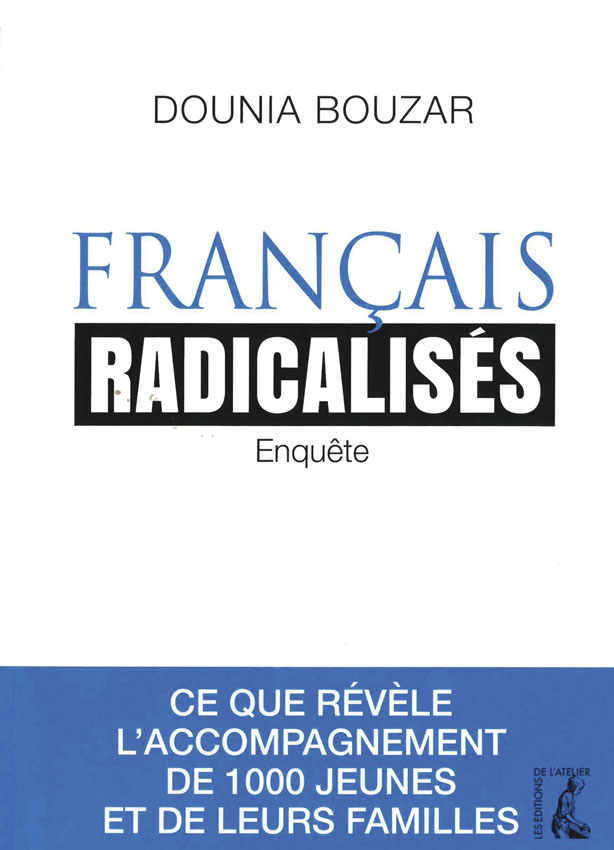
Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux, publie ici les résultats d’une enquête sur le djihadisme (dans le cadre d’un projet de recherche européen suite aux attentats de 2015), menée durant trois ans auprès de 1000 jeunes et de leurs familles. Ce que confirme cette enquête (plutôt qu’elle ne « révèle »), c’est cette sorte de triangle des Bermudes formé par l’environnement social (et non seulement les « conditions » sociales), la vulnérabilité psychologique et ce qu’on pourrait appeler la force de l’influençologie djihadiste (une force idéologique dans la diffusion de laquelle les moyens télé-technologiques tiennent une place importante). Ce triangle donne lieu à huit figures potentielles de « djihadistes » analysées par D. Bouzar comme autant de « promesses » (d’un monde plus juste, protecteur des plus faibles, de toute-puissance, de pureté, etc.) qui constituent les motifs d’engagement, plus ou moins implicites, des jeunes.
La force du livre est sans doute dans les témoignages recueillis auprès de jeunes et de leurs familles. Écouter, recueillir les paroles et les témoignages des jeunes concernés est probablement le meilleur moyen de résister à l’incompréhension de ce phénomène qui a brillé d’abord par une coupure radicale entre les visions de ces jeunes et un monde qui non seulement ne sait plus leur offrir de « promesses » mais les conforte dans leurs ressentiments, voire leur paranoïa, par des pratiques et des discours discriminants, des confusions installant une islamophobie diffuse et une ethnicisation de la radicalisation. Le tout aboutissant, pour les plus vulnérables psychologiquement, à une double exclusion, de soi-même et des autres. Le processus est simple d’une certaine façon et fonctionne pour les garçons comme pour les filles : culpabilisation et vision binaire du monde, adhésion aux thèses djihadistes, haine et déshumanisation de l’autre, légitimation de la violence et, éventuellement, passage à l’acte (partir en daeshie, combattre, devenir kamikaze, etc.). On comprend à travers les analyses de D. Bouzar que le djihadisme n’est pas une fatalité mais ce processus-même qui, une fois les ingrédients (psychologiques, relationnels et idéologiques) réunis, risque d’entraîner sur sa pente celles et ceux qui, sensibles à ce qu’ils perçoivent comme une injustice fondamentale ou radicale, c’est-à-dire ontologique (touchant à leur être et non seulement à leurs avoirs ou non-avoirs), ne rencontrent pas d’autres alternatives, ni de sens ni d’action, dont ils pourraient être l’adresse et avec lesquelles ils pourraient répondre autrement tout en demeurant dans le contrat social. En soi, c’est une question posée aux différents acteurs (institutionnels et civils) de la société quant à la déshérence dans laquelle vivent certaines catégories sociales…
Le travail de D. Bouzar s’inscrit également dans le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI), structure dédiée à la mission de prise en charge des radicalisés (en fait à la « déradicalisation »), à la demande du ministère de l’Intérieur (2014–2016). La notion de « déradicalisation » comme son objectif avaient donné lieu à l’époque à un débat, voire à des polémiques. D. Bouzar y consacre le dernier chapitre de son livre « Les étapes du processus de déradicalisation » se basant sur le fait que, dans l’échantillon des personnes qui étaient prises en charge par ce centre, 81 % des personnes suivies sont sorties de la radicalisation soit en rompant avec l’idéologie qui sous-tendait leur engagement soit en renonçant à l’utilisation de la violence. L’auteur explique en quoi a consisté cette « déradicalisation » : rompre le lien fusionnel avec les groupes djihadistes quitte à recourir à l’enfermement, proposer un nouveau groupe rassurant, envisager une approche émotionnelle en s’appuyant sur les proches, « faire émerger les premiers doutes », entamer une approche idéologique, etc. En fait, cela ressemble à une sorte de travail de déprogrammation, du moins à un modèle d’« intervention réhabilitative cognitivo-comportementale et émotionnelle des auteurs d’infractions »…
On peut adhérer ou non à ce genre d’intervention réhabilitative. Dans l’urgence, c’est probablement le genre de « réponse » à tenter... Cependant, l’analyse des données demeure plus intéressante, car elle laisse entendre que le phénomène du djihadisme, à l’instar d’autres (retour des « extrêmes-droites », montée des idéologies « identitaires » locales, des nouvelles formes de la xénophobie, etc.), trouve ses sources dans une mutation anthropologique profonde que les politiques actuelles (nationales et internationales) ne semblent pas en capacité d’accompagner, encore moins de réguler. Au-delà donc du djihadisme, c’est toute une « inquiétude moderne » (J.-L. Nancy) qui nous interpelle.
Abdellatif Chaouite