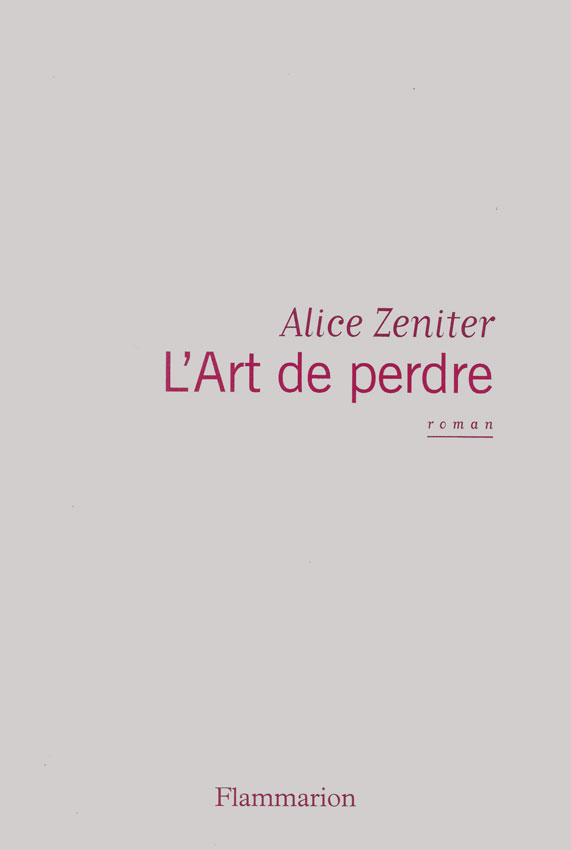
Alice Zeniter explique que c’est la lecture du livre « Sauve qui peut la vie » de Nicole Lapierre, qui lui a permis d’écrire L’art de perdre. Dans cet essai, paru en 2015, Nicole Lapierre sociologue, spécialiste de l’histoire de la Shoah, revient sur l’histoire de sa famille pour arriver à l’histoire des migrants d’aujourd’hui. Qu’ont-ils en tête au moment du départ ? Que ressent-on pour eux ? Et Alice Zeniter de préciser : « En la lisant, je me suis souvenue d’un vers d’Homère : les malheurs des hommes sont faits pour être chantés »… « Cela faisait des années que je tournais autour de l’envie d’écrire sur l’arrivée des harkis en France, sur le rapport au pays perdu et à la gestion de « la double absence » comme dit le sociologue Abdelmalek Sayad [1] : « l’absence du pays que l’on a quitté, et celle du pays que l’on pensait trouver en arrivant, et qui n’est pas celui où l’on s’installe... Au stade où j’en étais, dans mon parcours d’écriture, j’ai pensé que je pouvais parler de cette histoire, dire qu’elle était celle de ma famille, et ne plus avoir cette peur d’être définie par les actes de mon grand-père. » [2]
Alice Zeniter, 31 ans, est petite-fille de « harkis » et l’histoire des « harkis » n’a jamais été chantée dit elle. L’art de perdre n’est donc pas l’histoire de la famille d’Alice Zeniter, c’est une traversée du XXe siècle. C’est un regard jeté sur le monde depuis la campagne kabyle, la région de Palestro, là où tout a commencé historiquement en 1954, devenu après l’indépendance Lakhdaria. Cette histoire nous mène de la Kabylie à Monte Cassino, d’Alger à Rivesaltes, de Paris à Flers, de la Haute Durance à Tizi Ouzou….
Comme Naïma, la petite fille d’Ali, paysan dans la région de Palestro, Alice Zeniter est née en France d’un père kabyle et d’une mère française. Comme elle, elle est petite-fille d’un harki qui, parce qu’associé au pouvoir colonisateur français, a dû se résoudre à quitter son pays en 1962. Mais 60 ans après, Naïma, jeune Parisienne travaillant pour une galerie d’art, ignore tout ou presque de l’Algérie car son père Hamid a toujours refusé de raconter, de dire. Dans le livre d’Alice Zeniter, au delà des mots et des lignes il y a le silence comme l’ombre des mots et des maux.
Ali est un paysan pauvre qui cultive des oliviers sur des terres rocailleuses de Kabylie. Au fil du temps et de son travail, il agrandit son exploitation. Il achète terrain et maison. Devant cette « petite réussite » les jalousies apparaissent. Ali se veut d’abord et avant tout le défenseur de sa famille mais aussi du village ; parallèlement il participe à l’association des anciens combattants de l’armée française, il en est le vice président ; le président c’est Akli qui a fait la première guerre mondiale. Lui, il a fait la seconde, il était à Monte Cassino en Italie : « durant les quatre batailles du Mont, les hommes des colonies ont été envoyés en premières lignes : marocains, algériens, tunisiens du côté français, indiens, néo-zélandais du côté anglais, ce sont eux qui permirent aux alliés de perdre cinquante mille hommes... » À Monte Cassino, avec Ali il y avait Ben Bella et Boudiaf (premier et quatrième président de l’Algérie indépendante). « Peut être que l’histoire eût-elle été très différente » s’ils s’étaient rencontrés dans cette bataille.
Comme une ombre, surgit alors cette angoissante question : comment on choisit son camp ? : « Choisir son camp n’est pas l’affaire d’un moment et d’une décision unique, précise. Peut-être, d’ailleurs, que l’on ne choisit jamais, ou bien moins que ce que l’on voudrait. Choisir son camp passe par beaucoup de petites choses, des détails. On croit n’être pas en train de s’engager et pourtant, c’est ce qui arrive. Le langage joue une part importante. Les combattants du FLN par exemple, sont appelés tour à tour fellaghas et moudjahidines. Les qualifier de moudjahidines, c’est en faire des héros. Chez Ali, la plupart du temps, on ne les appelle que le FLN comme si lui et ses frères sentaient que choisir entre fellag et moudjahid, c’était déjà aller trop loin. Le FLN a fait ci. Le FLN a fait ça » (p.60).
Dès sa formation le FLN interdit toute collaboration avec la puissance coloniale, notamment avec l’interdiction de toucher les pensions d’anciens combattants. Cette interdiction allait provoquer les premières cassures au sein de l’association des anciens combattants, entre ceux qui acceptent puisqu’il faut des sacrifices pour accéder à l’indépendance, ceux qui disent comme Akli : « mais alors on se serait battu pour rien…. Et pour Akli si la pension est le signe qu’il s’est vendu aux français, il voit cette vente comme la preuve de sa dignité et non le contraire… » de plus les pensions sont une source de revenus réelle face à la misère si présente dans les villages. Ali sait qu’il n’a pas besoin de la pension pour vivre mais sans doute il ne supporte pas l’injonction, notamment par ce que les dirigeants qui ont commencé à apparaître, il les voit plus comme des jeunes paysans en colère et il ne comprend pas : « pourquoi il serait dirigé par ces hommes qui n’ont jamais rien fait pour mériter leur titre, les grades dont ils se parent ». En fait il a besoin de preuve pour croire à la lutte. Pour le reste, à 37 ans il a déjà donné. Il y a cette rivalité sourde, sournoise, générée par la prospérité nouvelle d’Ali qui vient déranger l’ancienne suprématie de la famille Amrouche sur le village. Si les Amrouche n’avaient pas été proches du FLN, sans doute le clan d’Ali n’aurait-il pas collaboré avec l’armée française, il ne serait peut-être pas devenu un « harki » comme dit Alice Zeniter, une « sorte de détenteurs d’un CDD paramilitaire renouvelable comme le comprendra plus tard Naïma ».
Entre les pressions, les ordres, les violences de l’armée française pour tout contrôler et l’assassinat par le FLN d’Akli, l’ancien combattant qui a refusé d’obéir, pour Ali la guerre a commencé son chemin de destruction, de perte et de blessures inguérissables. Ali est devenu un « habillé » selon la terminologie du FLN ; mais sur la fin de la guerre Ali se défendra d’être un traître. Devant son frère et sa sœur il dira : « je n’ai jamais dit que j’étais pour les Français, et je n’ai pas touché un fusil, ils n’ont (le FLN) aucune raison de nous en vouloir » mais la pression des vainqueurs est là ; elle oblige Ali a demander la protection de l’armée française. S’engage alors un dialogue avec un sergent : « qu’est ce que tu veux ? / Protéger ma maison dit Ali / pas possible/ donnez nous des armes / pas possible / emmenez nous ailleurs / pas possible / écoute, mon vieux dit le sergent, tu n’avais qu’a choisir le bon côté/ toi tu as choisi le bon côté ? / non, mais moi je suis Français répond le sergent et Ali de lui dire Moi aussi ! »
Blessure supplémentaire chez Ali, sa femme Yema et leurs trois enfants pourront rejoindre la France parce qu’une amie pied-noire est la maîtresse d’un capitaine : « Sur l’oreiller, dans le demi-sommeil qui suit l’amour, le capitaine promet à Michelle qu’il fera tout son possible… Il y a quelque chose d’absurde, d’obscène ou de tendre dans le fait que la survie d’une famille puisse être rendue possible par les courbes du corps de Michelle, par ses seins lourds, ses fesses pleines, son visage dans la pénombre de la chambre et les mèches de cheveux qui lui tombent sur les yeux. »
En septembre 1962, le monde d’Ali et de Yema s’est écroulé. Il va falloir tout repenser mais est-ce possible entre les barbelés du camp Joffre, appelé aussi camp de Rivesaltes, alors que personne ne vous accueille, ne vous nomme : « L’Algérie les appellera des rats. Des traîtres. Des chiens. Des terroristes. Des apostats. Des bandits. Des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu. La France se coud la bouche en entourant de barbelés les camps d’accueil. Peut-être vaut-il mieux qu’on ne les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner. Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi que ce soit. Rapatriés ? Le pays où ils débarquent, beaucoup ne l’ont jamais vu, comment alors prétendre qu’ils y retournent, qu’ils rentrent à la maison ? Et puis, ce nom ne les différencierait pas des pieds-noirs qui exigent qu’on les sépare de cette masse bronzée et crépue. Français musulmans ? C’est nier qu’il existe des athées et même quelques chrétiens parmi eux et ça ne dit rien de leur histoire. Harkis ?... Curieusement, c’est le nom qui leur reste. Et il est étrange de penser qu’un mot qui, au départ, désigne le mouvement (harka) se fige ici, à la mauvaise place et semble-t-il pour toujours. »
Le souffle de la dépossession se lit à chaque ligne, l’abandon, les stratégies de divisions dans le camp pour régner. Ville précaire de fragilité et d’urgence. Tout est là dans des pages lumineuses et tristes, le camp de Rivesaltes est décrit comme jamais il ne le fut pour les harkis. Dix mille personnes étaient internées dans des conditions infernales, c’était la seconde ville du département après Perpignan. Impossible d’oublier la guerre quand tous les matins il faut assister au lever des couleurs au son de la trompette ! Un jour, un juge vous convoque pour vous demander si vous désirez être français (ne le sont-ils pas déjà !) il faut alors signer un papier et si vous ne savez pas écrire, ce qui est le cas d’Ali et de Yema, les empreintes digitales feront l’affaire. Hamid le fils, le futur père de Naïma est présent, il ressent une nouvelle humiliation, ce père qui donne l’impression d’obéir à chaque injonction…
Le départ du camp de Rivesaltes se fait pour un autre camp, dans la nature celui-ci, pour satisfaire au travail proposé par l’ONF (Office National des Forêts). Pour la famille d’Ali et de Yema, ce sera le camp de Jouques ou la cité du logis d’Anne sur les rives de la Durance. Ouvert pour les harkis à titre provisoire en 1963, il fermera ses portes en 1988. Les mots ont-ils encore un sens avec un tel provisoire ? C’est avec la vie dans ce lieu que les vrais premiers contacts vont se faire avec la société française et ses contradictions, avec le racisme, la bêtise aussi parfois et des gestes fraternels. Pour les enfants, le premier choc c’est l’école : « les cours débutent comme à tâtons : je suis Hamid je viens de Kabylie/ je suis Mokhtar je viens de Kabylie/ je suis Kader je viens de l’Algérie française / non Kader, non l’interrompt nerveusement l’instituteur, ça n’existe plus l’Algérie française. Moment de perplexité qui rend les enfants muets… comment fait-on disparaître un pays ? se demandent-ils » p.195.
Puis c’est le départ pour Flers, un peu comme un vrai départ avec valises, bus, sans encadrement policier. La ville a construit plusieurs barres d’HLM pour loger des ouvriers ; mais : « C’est un paysage dessiné à la règle, à grands traits logiques : angles et arêtes des bâtiments, démarcations entre les dalles des plafonds, les rouleaux de lino au sol, lignes des rampes, froides sous la main, qui traversent la cage d’escalier. C’est un système qui s’épuise en parallèles et en perpendiculaires à force d’être répété à toutes les échelles dans les bâtiments. Les gros plans sur un détail de l’appartement que les enfants obtiennent en collant le nez contre un mur n’offrent que des lignes droites, de même que la vue sur le quartier que l’on peut avoir depuis le tertre à l’arrière des immeubles. Il n’y a pas de repos, pas de répit dans ce monde d’équerres... » (p.215). Dans ce monde froid, les rares objets sauvés de l’Algérie ne vont pas trouver leur place, ils détonnent et deviennent une curiosité. Ils finiront dans un tiroir. Longtemps après, les petits enfants demanderont leurs significations.
C’est à Flers en Normandie que le fossé va se creuser entre Ali et Yema et leurs enfants. Les trois enfants, nés en Algérie, vont devenir au fil des épreuves des enfants français avec un rapport à l’Algérie qui se complexifie. Dans un bar parisien Hamid retrouve Annie son amie de Palestro, contrairement à la famille d’Ali, elle est partie dit-elle, elle n’a pas été chassée. Elle propose à Hamid de revenir en Algérie avec elle pour retrouver ses racines. Mais Hamid est ailleurs et le lui dit : « les miennes elles sont ici, je les ai déplacées avec moi. C’est des conneries ces histoires de racines. Tu as déjà vu un arbre pousser à des milliers de kilomètres des siennes ? Moi j’ai grandi ici alors c’est ici qu’elles sont ».
Hamid, au fil des ans et des rencontres, abandonne la religion musulmane et découvre dans les années 1970 le marxisme, les luttes sociales, les combats contre la guerre du Vietnam qui le ramènent au choix de son père. Il viendra questionner pour enfin avoir des réponses, mais toujours ce silence destructeur. En 1972 Hamid rencontre Clarisse jeune femme qui porte sa génération sans honte, avec enthousiasme. La génération de la prise de parole des femmes. Pour Clarisse, intellectuelle et artiste « elle sait tout faire de ses mains », la parole est un acte libérateur, un acte constitutif de l’amour au même titre qu’elle dira à Hamid, dés les premiers pas de leur rencontre, « tu m’embrasses ? Comme elle aurait pu dire offre-moi une clope ». Hamid, un jour, racontera ses blessures intimes parce que Clarisse lui explique que c’est la condition d’une possibilité de l’amour. Les enfants vont naître dont Naïma.
Ce que Hamid a raconté à Clarisse, il ne voudra pas le dire à sa fille qui s’interroge sur l’Algérie présente et absente dans sa famille. Si, pour elle, l’Algérie est une question, elle n’est surtout pas un empêchement. Naïma travaille dans une galerie d’art contemporain. Christophe s’intéresse aux œuvres d’art produites dans les pays colonisés durant les années de la décolonisation. Dans son bureau, Naïma voit les livres de Glissant et Fanon ; Christophe lui demande si elle les a lus, elle lui répond « je ne vois pas pourquoi ». La seule fierté de Naïma c’était d’avoir fait des études qui ne servaient qu’à l’enrichir intellectuellement en étudiant l’histoire de l’art. Naïma a peur, « peur de faire des fautes de français, peur qu’on lui demande en quelle année sa famille est arrivée en France, peur d’être assimilée aux terroristes » Christophe va proposer à Naïma de diriger une exposition du peintre algérien Lalla, lui disant qu’elle devra aller en Algérie et particulièrement en Kabylie que le peintre a quittée pour venir vivre en région parisienne après la décennie noire des années 90. Elle a beaucoup hésité avant d’accepter après une rencontre avec Lalla. Avec lui, elle découvre une communauté d’intellectuels et d’artistes debout à travers toutes les turbulences de l’histoire. Une communauté qui écrit, dessine, peint, et parle. Pour préparer son voyage, sa famille faisant silence, elle utilisera le web et son infini contenu mais, à lire et découvrir, elle se dit « que sous son ordinateur se trouve une immense caverne souterraine où se débattent des monstres tordus aux visages de haine…elle préfère alors se rabattre sur le support, plus calme, moins furieusement participatif, le livre »
Apres l’obtention de son visa, elle se rend en Algérie à Tizi Ouzou, elle rencontre les amis de Lalla, elle passe avec eux des moments qui ressemblent à ceux de la galerie, les discussions, la fête, l’alcool, le tabac, la musique, elle découvre Matoub Lounès. Ce sont ces nouveaux amis de Tizi Ouzou qui lui disent d’aller voir sa famille et qui l’emmènent sur le chemin des crêtes de Palestro dans sa « famille inconnue » à Lakhdaria.
Ifren, le neveu de Lalla qui lui sert de chauffeur et qui a sympathisé avec elle, lui dit sur le chemin du retour : « Personne ne t’a transmis l’Algérie. Qu’est-ce que tu croyais ? Qu’un pays, ça passe dans le sang ? Que tu avais la langue kabyle enfouie quelque part dans tes chromosomes et qu’elle se réveillerait quand tu toucherais le sol ? »
Quant le bateau quitte le port d’Alger – elle a voulu faire ce voyage en bateau –, elle ne sait pas si c’est un adieu ou un simple au revoir….
Dans les dernières pages du livre, alors qu’elle longe la Méditerranée avant de parvenir au port, elle entend Ifren lui dire : « il y a des choses qui se perdent… on peut perdre un pays », avant de lui demander si elle connaissait la poétesse américaine Elisabeth Bishop et de lui réciter son poème Un art : « Dans l’art de perdre il n’est pas dur de passer maître / tant de choses semblent si pleines d’envie / d’être perdues que leur perte n’est pas un désastre... », mais il ne lui récitera pas la dernière strophe : « Même en te perdant (la voix qui plaisante, un geste que j’aime) je n’aurai pas menti. A l’évidence, oui,/ dans l’art de perdre il n’est pas trop dur d’être maître / même si il y a là comme (écris-le !) comme un désastre. »
Elle sourit à cette récitation inattendue, et Ifren lui dit : « ce qu’on ne transmet se perd c’est tout. Tu viens ici mais ce n’est pas chez toi ».
En refermant le livre d’Alice Zeniter comment ne pas penser à toutes celles et ceux qui cherchent le chemin de leur liberté, à celles et ceux que l’histoire a transformés en vaincus. Mais Ali en quittant l’Algérie a ouvert à sa descendance, sans le vouloir, le chemin des interrogations universelles émancipatrices. En partageant la vie de Naïma on pense bien évidemment à Jean-Paul Sartre qui disait : « L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous. » . Comment agir, penser, réagir par soi-même loin de toute assignation et Alice Zeniter nous dit que ce n’est pas à autrui à nous imposer nos choix mais à chacun de trouver le chemin de sa singularité, de sa liberté.
Ce livre magnifique vient d’obtenir le prix Goncourt
des lycéens, élu par un jury de 2000 lycéens.