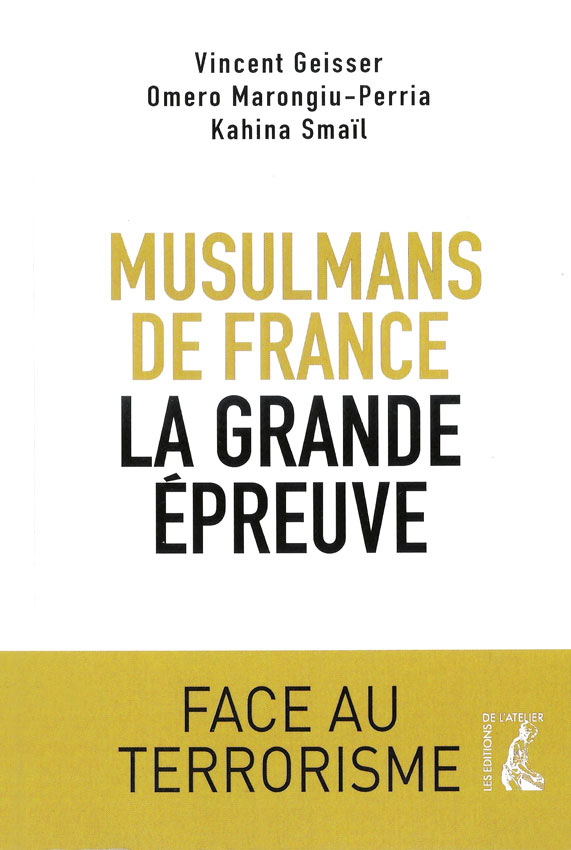
La profusion des discours ces dernières années sur l’islam, l’islamisme, le djihadisme, l’islamophobie et, plus récemment (surtout depuis les attentas de 2015-2016) le radicalisme, appelait (« traquait » disent les auteurs), d’une manière ou d’une autre, les musulmans de France à se positionner : contre les actes de terrorisme par exemple... Au-delà des postures politiques et idéologiques des uns et des autres, il y a là un piège classique qui guette le minoritaire : il lui faut toujours se prononcer, déclarer, témoigner, manifester, justifier, en somme faire à chaque fois acte d’allégeance. La méfiance (en toutes ses variances : « victimaire », « moralisatrice », « suspicieuse » ou « opportuniste ») étant maître d’œuvre dans ces affaires, c’est un serpent imaginaire (une « fiction ») qui se mord la queue : il se nourrit surtout, mais de manière combien performative, de son ombre ou de son spectre.
Il fallait donc bien que quelqu’un se coltine cette question et autrement, en l’inversant en quelque sorte : « en contrepoint, l’une des hypothèses majeures de notre enquête est de montrer que les musulmans de France n’ont pas été invisibles dans les mobilisations collectives post-attentats – cela n’a d’ailleurs pas été prouvé –, mais ils ont fait l’objet d’un processus d’invisibilisation. Leur invisibilité dans les différentes initiatives contre le terrorisme relève moins d’un fait social attesté et vérifié que d’une construction politique et médiatique. »
Les auteurs passent notamment en revue les différentes réactions des organisations et acteurs musulmans, officiels et institutionnels ou non, après les attentats (en termes de prises de parole et d’actions). Même si ces attentats ont suscité des réactions tous azimuts (en lien aussi bien avec la diversité sociale, culturelle ou d’âge de la composante dite musulmane de la population de France, qu’avec celle de la formation des imams par les différentes fédérations), ces réactions contredisent la thèse d’un « silence musulman » ou d’un « boycott musulman », relevant d’une vision idéologique cultivée par l’extrême-droite et certains leaders politiques, et reprise par certains médias et intellectuels. D’autant que le dialogue interreligieux bat son plein et incite à développer des initiatives anti-violence à plusieurs échelons.
L’enquête ne se résume cependant pas à ce rappel mais creuse le sillon des méandres de la refondation en cours d’un islam français par le biais de l’activation du dialogue interreligieux et d’initiatives critiques et auto-critiques d’acteurs musulmans divers. Cette critique est à la fois séculariste, intellectualiste, spiritualiste, anti-coloniale et générationnelle, et pourrait se révéler plus efficace quant à « l’endiguement de la propagande djihadiste chez les personnes susceptibles de se radicaliser » que certains programmes de déradicalisation, extérieurs de par leur nature à la sensibilité des concernés. De même qu’elle révèle les « fractures sociales et générationnelles dans l’islam de France ».
Assurément, le paysage de l’islam qui se dessine à travers cette enquête est à des milliers de lieues de ce à quoi sa médiatisation le réduit, à travers par exemple les controverses qui ont eu lieu au sujet d’un positionnement en termes d’un « je suis Charlie » ou je suis autre chose. Comme si cette dichotomie, ou d’autres, pouvait établir un quelconque indice de confusion ou de non confusion entre le fait d’être musulman et ce qu’on appelle le radicalisme, et alors même que les musulmans ordinaires ont apporté largement « leur contribution à la lutte contre la radicalisation et au renforcement de la cohésion sociale », à la fois en termes d’implications locales et de « décryptage » du phénomène djihadiste, comme en termes de construction d’une « théologie de la riposte » et d’un contre-discours de réfutation des discours terroristes.
Au final, il apparaît que dans cette « grande épreuve » que traverse l’islam de France, « le terrorisme islamique… reste paradoxalement sous-analysé par les chercheurs », au profit de spéculations, confusions et sensationnalismes qui nourrissent les débats publics sur l’islam. Le livre fait la preuve que « Le moment terroriste a permis de déconstruire l’idée d’une entité musulmane dans l’Hexagone, de remettre en cause le cliché d’une communauté homogène et de rompre définitivement avec la thèse d’un habitus musulman qui structurerait mécaniquement les attitudes ». Et c’est déjà une bataille gagnée sur le confusionnisme comme sur le terrorisme a-t-on envie de dire. Reste à gagner celle qui se joue toujours : « banaliser la présence et l’expression de la religiosité musulmane dans l’espace public » et son corollaire dans les têtes, la construction d’une « islamo-laïcité ».